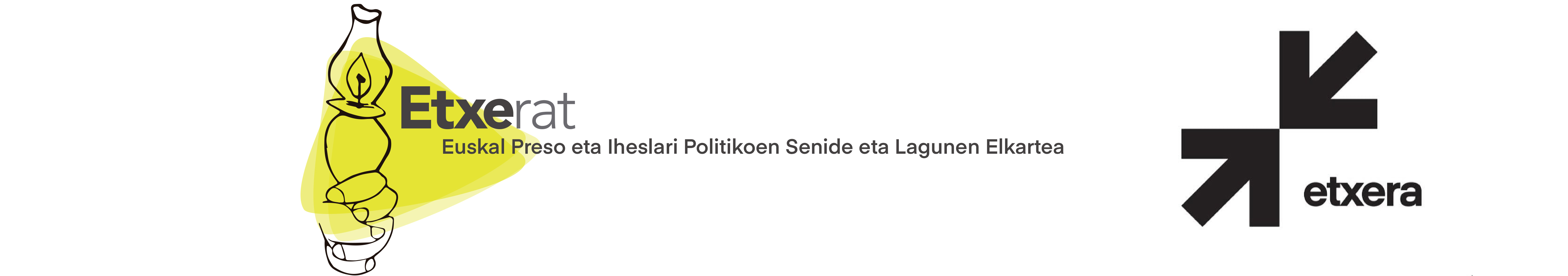ETXERAT (06-06-2019). En raison de son intérêt informatif, nous reproduisons ici l’entretien réalisé par les journalistes Maite Ubiria et Goizeder Taberna à Anaiz Funosas, Jean-René Etchegaray et Mixel Berhokoirigoin, membres de la délégation du Pays Basque nord, publié aujourd’hui dans GARA et MEDIABASK.
Membres de la délégation du Pays Basque, le président de l’Agglomération Jean-René Etchegaray, la présidente de Bake Bidea Anaiz Funosas et l’Artisan de la paix Mixel Berhocoiringoin espèrent pouvoir fermer le premier volet de ce processus sous peu afin de pouvoir ouvrir le second : celui de la justice transitionnelle. Ils comptent pour cela sur la force du territoire. Bake Bidea organise les 7 et 8 juin une conférence et une chaîne humaine pour donner une nouvelle impulsion à la résolution du conflit.
Le 10 juillet 2017 la délégation basque s’est rendue pour la première fois au ministère de la Justice. Quel bilan faites-vous de ces deux années ? Quelles sont les forces et faiblesses de cet espace de dialogue ?
Jean-René Etchegaray : La dernière rencontre que nous avons eue au ministère de la Justice fait suite à une période où nous avons considéré ne pas avoir été suffisamment entendus par le Gouvernement. C’est vrai que dans ce processus de paix, il y a des hauts et des bas. Notre dernière rencontre s’inscrit dans une période positive, tout au moins au niveau des engagements. Le rapprochement des prisonniers déjà engagé précédemment va se poursuivre, la levée des statuts des DPS (détenu particulièrement signalé) de même. Sur ces deux sujets, nous avons le sentiment d’avoir été entendus, la question est de savoir si nous serons suivis.
Dans le dossier des prisonniers, il y a aussi la question des demandeurs de libération conditionnelle. Les demandes répétées de trois d’entre eux n’ont jamais pu arriver à terme du fait de circonstances, d’après nous, incompréhensibles. Aujourd’hui, le logiciel judiciaire ne tient pas compte de l’évolution du processus de paix au Pays Basque, notamment du désarmement et bien sûr de la dissolution d’ETA. Or, aujourd’hui, nous considérons que la paix ne sera possible que si nous avançons sur la situation des victimes et des prisonniers. Dans le cas de Jon Kepa Parot, en première instance, il a eu une décision favorable du juge, mais le parquet a fait appel de ce jugement. Il y a un véritable problème au niveau du parquet en France.
C’est d’autant plus surprenant que le tribunal administratif de Paris vient d’annuler une décision de l’Administration pénitentiaire, considérant qu’il faut tenir compte de l’évolution du processus de paix au Pays Basque. C’est écrit noir sur blanc. La même décision dit qu’il faut tenir compte de l’âge de la mère de Karrera Sarobe et celui de ses filles, donc accepter le rapprochement familial. Ce jugement donne un éclairage nouveau. Ce n’est bien sûr pas la jurisprudence du juge pénal s’agissant des demandes de libération conditionnelle, mais nous appelons de nos veux que le parquet tienne compte de cela. C’est un point sur lequel nous attirons l’attention du Gouvernement et de tous ceux qui participent au pouvoir judiciaire, dont on reconnaît en même temps l’indépendance.
Anaiz Funosas : La force de cet espace de dialogue est avant tout le schéma de travail mis en place au Pays Basque Nord depuis la Déclaration d’Aiete et l’intelligence qu’a eue ce territoire de savoir combiner accords politiques transversaux, implication des élus et participation active de la société civile. Quand la délégation arrive au ministère, elle arrive avec un mandat accordé par une majorité du territoire qui a établi une feuille de route, la Déclaration de Bayonne. Par ailleurs, nous avons réussi à mettre en place un dialogue ayant intégré les prisonniers eux-mêmes. Cet espace s’est construit avec la compréhension de tout le monde et, malgré des hauts et des bas, avec des interlocuteurs qui ont toujours cherché la résolution de ce processus.
Les faiblesses, c’est le refus du parquet antiterroriste de changer de logiciel. C’est un réel obstacle pour pouvoir concevoir le règlement de la situation des prisonniers du point de vue global dans la perspective d’un vivre-ensemble. Autre point faible, le manque d’engagement total des deux gouvernements pour aller jusqu’au bout de l’exercice. C’est la question des prisonniers, des exilés, celle de toutes les victimes... Pour arriver réellement à regarder notre passé, il va falloir que les Etats contribuent de manière active et positive à ce processus, bien que nous reconnaissions les pas déjà franchis. Alors que depuis Aiete il n’y a pas d’espace de négociation, d’avoir réussi par la voie unilatérale à ouvrir au moins au ministère de la Justice [français, ndlr.] cette interlocution, c’est un élément très important dans ce processus.
Mixel Berhocoirigoin : Cette discussion est assumée publiquement, par les pouvoirs publics, par notre interlocutrice et également par la ministre de la Justice. C’est assumé vis-à-vis de l’opinion, vis-à-vis de l’Espagne, vis-à-vis des différents protagonistes de ce dossier. Il y a eu un moment délicat, de flottement et même de désaccord, et je pense que c’est peut-être même normal et rassurant. Cela veut dire que nous sommes dans une discussion dont le poids symbolique et politique est très important. Cela nous oblige aussi à réfléchir sur notre stratégie et à consolider la convergence entre différentes forces. Dans ce processus, nous sommes dans une démarche atypique, unilatérale, ce n’est que cette convergence des forces, autour de la société civile, qui peut le tirer vers l’avant.
Nous pensons tout de même pouvoir arriver assez rapidement à la fin du premier niveau d’objectifs. Ces objectifs sont la suppression de toutes les mesures d’exception, mais nous sommes là pour aller au-delà. Nous voulons ouvrir un autre espace, nous verrons comment, mais nous devons ouvrir un autre cadre juridique pour que la prison ne soit plus la perspective des gens qui sont aujourd’hui incarcérés.
Pensez-vous pouvoir aborder cette question avec le ministère ?
M. B. : Il est clair que nous devons aborder cette question à ce niveau-là. Un certain nombre de signes laissent présager que ce dont nous sommes en train de discuter n’est pas la fin du dossier. C’est comme le reste, il faut faire le chemin progressivement. Nous sommes dans la co-construction. Si Emmanuel Macron dit que le Pays Basque "est un exemple de résolution d'un conflit", c’est nouveau. Ce n’est pas le fruit du hasard, mais le fruit de toutes ces discussions. Cela fait moins de deux ans que la délégation est montée à Paris. Deux ans, c’est long et c’est court à la fois. On est dans une évolution qui nécessite du temps. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses doivent changer. Au-delà de ce qui se voit, nous sommes dans un scénario où les esprits évoluent. Cette évolution va rendre possible ce qui, il y a peu de temps encore, paraissait impossible.
La manifestation du 12 janvier dernier a apporté un nouvel élan à votre démarche. Le président Emmanuel Macron a même exprimé une certaine reconnaissance du chemin parcouru. M. Etchegaray, vous avez participé à la rencontre des élus avec le président, quelle a été votre impression ?
J.-R. E. : Il avait une écoute totale sur le sujet. Nous avions un président de la République qui était là pour nous entendre et lorsqu’il posait des questions, montrait la connaissance qu’il avait du dossier. Il avait envie de comprendre. Il n’a pas fait part de ses décisions sur le moment, ce serait impossible de la part d’un président. Je ne vais pas donner de détails de cette conversation pour ne pas trahir sa pensée. Il a compris ce qu'il se passait au Pays Basque, cela s’est vu aux travers des questions qu’il a posées.
Maintenant, je lui ai indiqué que la dernière arrestation [celle de Josu Urrutikoetxea, ndlr.], même si elle avait un fondement, était une mauvaise nouvelle pour le processus de paix. Il a compris ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu’il a abondé dans ce sens, puisqu’il était au contraire venu dire que la police faisait son travail et qu’il y a un temps peut-être judiciaire, et il y a un temps politique. Le président de la République est parti en ayant tous les éléments que nous avons pu lui transmettre, avec notamment Vincent Bru, Michel Veunac et Frédérique Espagnac. Je crois qu’il a compris que le territoire maintenait une position plutôt majoritaire sur le sujet.
Cette occasion nous a été offerte grâce à l’organisation du G7. Je pense que le président de la République souhaite qu’il se déroule dans de bonnes conditions. J’ai pour ma part la conviction qu’on se donne davantage de chances de réussir son organisation si on est en situation de donner des gages de la compréhension qu’on a sur la situation de notre territoire.
La veille de sa visite, Josu Urrutikoetxea a été arrêté. Après le départ du président de la République, nous avons eu droit à un rapprochement. Y a-t-il un manque de cohérence de la part du Gouvernement ?
A. F. : Je dirais qu’il n’y a pas de décision ferme de vouloir aborder cette question de manière globale et cohérente. L’arrestation de Josu Urrutikoetxea est en effet politiquement inquiétante. Et c’est vrai que nous avons été surpris des mots prononcés par ce président au lendemain de cette arrestation. Je n’ai jamais entendu un président de la République aborder la question basque à travers une terminologie de processus de paix, alors que nous n’avons pas de réel engagement de l’Etat français aujourd’hui. Est-ce que c’est un signe pour rassurer ? En tout cas, il va falloir que cela se concrétise.
Le rapprochement de Mikel Karrera est la conséquence de la reprise du dialogue avec le ministère et un tribunal administratif de Paris qui met tout le monde face à ses responsabilités. En tant que membre de la société civile, je dirais que c’est en maintenant un rapport de force qu’on va réussir à faire avancer les choses dans le bon sens.
Une décision de justice a permis, effectivement, le rapprochement de Mikel Karrera. Faut-il le prendre comme un cas isolé ? Nous sommes encore loin d’une évolution dans le sens de la justice transitionnelle...
J.-R. E. : Je souhaiterais y voir les prémices de ce que doit être une justice transitionnelle. Des éléments positifs permettent de penser que nous allons peut-être dans cette direction. D’une part, le fait que c’est un jugement du tribunal de Paris, et que quand un jugement est rendu par cette juridiction, je ne dis pas qu’il fait jurisprudence, mais généralement, ce sont des décisions qui ont une certaine force. D'autre part, ces arguments sont des critères objectifs que l’on trouvera dans bien d’autres situations. Et puis, le fait que l’ETA a décidé de cesser la lutte armée est un des motifs de la décision. Ce raisonnement judiciaire doit pouvoir être transposé dans bien d’autres situations et doit pouvoir venir nourrir des décisions que nous espérons positives pour les futures demandes, notamment, de libération conditionnelle.
Vous n’avez pas de garantie pour d'éventuels rapprochements à venir ?
J.-R. E. : Des garanties absolues, je crois qu’on ne peut pas dire qu’on en ait, parce qu’on ne sort pas des réunions avec des engagements écrits du ministère. En revanche, nous avons rétabli, et c’est important, une forme de confiance, qui avait un peu disparu au moment où le ministère et le gouvernement avaient considéré que la situation des prisonniers dépendait peut-être aussi de la façon dont on abordait la question des victimes. Nous n’avons jamais nié pour ce qui nous concerne que la situation des victimes était aussi importante que celle des prisonniers. Et nous sommes convaincus que si nous n’avions pas fait ce travail avec les prisonniers, que si un certain nombre de prisonniers ne s’étaient pas prêtés à l’exercice, s’il n’y avait pas un certain nombre de membres de l’ETA, y compris d’ailleurs Josu Urrutikoetxea, qui a lu la Déclaration faite le 3 mai à Genève, la veille de la rencontre de Cambo, nous n’en serions pas là. Il n’y aurait eu ni désarmement, ni dissolution. C’est ce que nous tentons d’expliquer.
Je pense que le Gouvernement l’a compris. Maintenant, il faut le reconnaître, des victimes organisées dans certaines associations tiennent, peut-être parfois, un discours qui peut avoir un certain écho suivant la situation politique dans laquelle on se trouve de l’autre côté de la frontière. C’est aussi vrai en France. Il y a toujours un contexte politique qui rend les choses faciles ou difficiles. Je considère que, après que les élections se soient déroulées du côté espagnol, les choses seront peut-être plus faciles. Il faut une certaine stabilité politique, sans doute, pour que l’on puisse faire avancer sérieusement les choses parce que tout ne dépend pas que du gouvernement français ou que du gouvernement espagnol.
Le fait que certaines associations de victimes, en particulier l’association Covite, ne se soient pas opposées à ce rapprochement, malgré son poids symbolique, signifie-t-il quelque chose ?
J.-R. E. : C’est important. Covite fait partie des associations qui ont accepté de nous recevoir. A priori, elle a reçu une personne favorable au processus de paix et est donc prête à l’entendre. Cela montre qu’il y a malgré tout, encore, et heureusement d’ailleurs, une possibilité de lumière sur ce dossier. Il y a des actes positifs parfaitement perceptibles. Les déclarations faites par les uns et les autres. La manière dont certains juges se prononcent. Nous avons malgré tout un certain nombre d’interlocuteurs qui comprennent. Je crois que l’entrée vers la justice transitionnelle est étroite, mais j’ai le sentiment qu’on peut quand même y entrer.
M.B. : Nous sommes convaincus du fait que le processus va peut-être amener les victimes à avancer différemment. Il y a beaucoup de victimes qui ne se reconnaissent pas dans les associations parce qu’elles ne veulent pas être instrumentalisées. Bien que [les membres de ces associations] soient porteuses de beaucoup de souffrances passées, on ne peut pas refaire l’histoire. Il y a eu une histoire, elle a ses causes, ses explications, elle a ses victimes dans tous les camps. Il n’y a pas de hiérarchie entre elles, toutes les victimes sont dans la même humanité. Ce que je vois, c’est qu’il y a des victimes qui veulent contribuer à un Pays Basque où l’on peut vivre ensemble. Ces victimes sont peut-être moins organisées que les autres, mais elles sont les plus nombreuses.
A. F. : La seule garantie que l’on a pour que les choses se poursuivent tient à la capacité que ce territoire aura à travailler sur la compréhension du processus de paix. Ma seule crainte est que tout le monde délègue à la délégation l’avancement de ce processus. Elle est là pour représenter ce qui est fait ici et convaincre Paris du bon sens de la marche. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus le rapprochement de Mikel Karrera Sarobe. C’est vrai qu’il est lié à une décision d’un tribunal administratif de Paris, mais nous ferons tout pour qu’elle fasse jurisprudence.
On vous a reproché de ne pas vous investir autant sur la question des victimes que sur celle des prisonniers. Pourrions-nous imaginer des initiatives des deux côtés du Pays Basque, compte tenu des récentes déclarations de l’association des familles de prisonniers, Etxerat, et même de victimes d’ETA demandant la reconnaissance de toutes les souffrances ?
J.-R. E. : Sur la première question, j’ai effectivement demandé à rencontrer toutes les associations de victimes, je l’ai fait savoir au ministère de la Justice qui a trouvé cette démarche pertinente. J’ai effectué le maximum d’efforts pour m’adresser à elles. J’ai été reçu par l’association Covite, j’ai un rapport avec l’une des deux autres associations. Quant à la troisième, je ne l’ai pas rencontrée parce que je n’ai pas pu avoir de rendez-vous. L’entretien avec Covite m’a beaucoup intéressé. Je ne sais pas s’ils étaient aussi intéressés par ce que j’ai pu leur dire. J’ai compris d’ailleurs une certaine surprise de leur part de voir un élu s’exprimer comme je le faisais. Ce n’est pas dans les habitudes de l’autre côté de la frontière. Je parlais tout à l’heure du contexte politique, il joue pour beaucoup dans cela.
La déclaration d’Etxerat m’a beaucoup intéressé. Du reste, lors de la conférence du 7 juin, nous souhaitons expliquer que nous sommes des artisans de la justice transitionnelle. Nous souhaitons mettre autour de la table toutes les victimes et tous les prisonniers, en tout cas toutes les parties prenantes. Notre rencontre de Biarritz se veut être aussi cette ouverture que l’on souhaite faire dans ce que nous avons considéré à ce jour comme un espèce de mur des Etats, à la fois français et espagnol. Je dis cela tout en ayant conscience que nous avons eu un Premier ministre sous la présidence Hollande, Bernard Cazeneuve, qui a fait avancer les choses de manière significative, parce que ce qui s’est passé à Bayonne n’aurait pas été possible s’il n’avait pas été là. Et de la même manière, je ne néglige pas non plus l’ouverture du Gouvernement actuel.
Il ne faut pas oublier que nous avons commencé cela en octobre 2011 à Aiete. Pendant presque six ans, nous avons eu une forme d’indifférence insupportable de la part des Etats. Et si la société civile s’est organisée comme elle l’a fait, si nous avons eu en décembre 2016 Luhuso, si on a eu toutes les étapes qui ont suivi, c’est tout simplement parce qu’à un moment donné, la société s’est levée et est venue expliquer : "mais vous ne pouvez pas, vous les Etats, rester dans cette indifférence". On ne peut plus parler d’indifférence de l’Etat français aujourd’hui. Pour autant, j’ai déjà indiqué les signes que nous attendions.
M. B. : Il n’y a pas d’autre solution, il faut que les victimes participent au processus de paix et de réconciliation. Il y a le poids de l’histoire, le poids des situations vécues, mais quand on parle victime, on n’oublie pas les prisonniers et inversement, quand on parle prisonniers, on n’oublie pas les victimes. Je pense que ce message fait son chemin. C’est une conviction qui doit être partagée, le vivre-ensemble ne se décrète pas, ce n’est pas une décision ministérielle ou celle d’un parti politique, cela se construit à partir de la société. Sans cela, chacun reste avec ses plaies, son histoire, sa haine, sa vengeance et on a une société fragmentée.
Le rôle de la société civile avant, pendant et même après le désarmement est bien connu. Son engagement a été entier jusqu’à l’aboutissement d’une étape clé du processus, il y a un an, à Arnaga. Après la disparition d’ETA, quelle serait la mission principale de la société civile ?
A. F. : Son premier défi, c’est qu’elle s’empare de la question. Quand on parle du vivre-ensemble, c’est avant tout de nous que nous parlons. A partir du moment où nous serons amenés à vivre ensemble sur ce territoire, il va falloir que nous déterminions le chemin qui nous permet de construire cette coexistence, sachant qu’il y a tout un passé... qu’il y a des passés. Il faut que nous arrivions à les regarder. Les accepter ne veut pas dire cautionner. La plus grande garantie pour que les choses ne se renouvellent pas, c’est qu’il y ait une société civile plus qu’active pour pouvoir transmettre. C’est cela aussi l’enjeu de demain : "quelle compréhension de ce passé donnons-nous à cette génération qui se construit depuis Aiete ?".
Ce que j’apprécie au Pays Basque Nord, c’est que nous avons abordé toutes les questions sans tabou, et nous avons toujours estimé que les choses ne devaient pas se mettre en opposition, mais qu’il s’agissait de pièces d’un même puzzle, et que chaque pièce posée permettait de pouvoir poser l’autre. On nous a beaucoup reproché d’oublier les victimes, mais ce que l'on nous a reproché avant tout, c’est d’aborder ces questions-là en même temps qu’on aborde les questions des prisonniers, des exilés... Ma conviction est que tout est lié.
M. B. : Beaucoup de choses ont été faites depuis Aiete. C’est toujours le pas d’après qui valide les pas réalisés. Nous sommes dans un processus sans condition, rien n’est négocié ni accordé, il s’appuie sur la confiance que le processus lui-même sera assez fort et assez fructueux pour qu’il aille au bout. Je pense qu’il faut l’alimenter par des faits, ce n’est pas quelque chose d’abstrait. C’est pour cela que nous parlons des trois prisonniers qui sont à trente ans d’incarcération. Il faut les sortir de prison, ce sont des faits comme celui-là qui vont alimenter le processus.
L’engagement des élus, toutes familles politiques confondues, a été un atout majeur de cette voie basque vers la paix. Avec à l’horizon les élections municipales, le processus de paix pourra-t-il compter sur vous, M. Etchegaray, après 2020 ?
J.-R. E. : Le territoire a porté ce processus de paix, c’est tout à fait vrai. L’initiateur est la société civile, indiscutablement. Mais, et je m’en suis réjoui, l’ensemble des élus du Pays Basque ont répondu présent. Lorsque nouvellement élu à la présidence de la Communauté d’agglomération Pays Basque, alors que le processus de paix a commencé avant sa création, j’ai toujours obtenu l’unanimité de l’ensemble de mes collègues élus. Cela n’est pas rien. Nous sommes un territoire composé de 158 communes, près de 320 000 habitants, la deuxième agglomération après la métropole de Bordeaux dans la Région Nouvelle-Aquitaine. En disant cela, je crois pouvoir dire aujourd’hui que notre pays pèse.
Ce territoire a une histoire, il porte un projet. Plusieurs générations ont vécu dans un conflit, le dernier conflit d’Europe occidentale. Que nous ayons, nous, le territoire Pays Basque, souhaité à l’unanimité vouloir nous inscrire dans ce processus de paix est tout simplement normal. Nous avons envie que nos petits-enfants connaissent une paix durable. Elle dépend bien sûr de nous aujourd’hui, elle dépend de ceux qui seront demain issus du suffrage universel.
Je ne sais pas quels seront les maires de demain, je ne sais pas qui sera le président de l’intercommunalité de demain, parce que cela dépend des décisions que prendrons les élus de partir ou ne pas partir à l’élection, et ensuite, cela dépendra aussi des résultats. Mais, je crois que l’on aura franchi une étape irréversible. Cette étape est une étape historique. Personne n’est autorisé à revenir en arrière, même s’il a la meilleure onction démocratique possible. Il ne faut pas mépriser le passé et cette paix fait partie de notre histoire, d’une manière indélébile, comme inscrite dans le marbre.